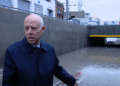Avec « La Vie après Siham », présenté à Cannes 2025 dans la sélection de l’ACID, le réalisateur franco-égyptien Namir Abdel Messeeh livre un documentaire d’une rare intensité émotionnelle. Ce film autobiographique, à la fois journal de deuil, enquête familiale et geste cinématographique profondément personnel, confirme la singularité de son auteur, déjà salué pour le très beau « La Vierge, les Coptes et moi » en 2011, un film qui mêlait documentaire et reconstitution, et qui avait remporté le Tanit d’argent documentaire aux Journées Cinématographiques de Carthage en 2012.
Né à Paris en 1974 dans une famille copte égyptienne, formé à la FEMIS, Namir Abdel Messeeh a toujours inscrit son œuvre dans une exploration des identités multiples, entre France et Égypte, entre croyances héritées et regard critique. Dans La Vie après Siham, il poursuit cette quête intime en revenant sur une promesse faite à sa mère avant sa mort : raconter son histoire. Le film devient ainsi non seulement un portrait d’outre-tombe, mais aussi un acte de fidélité, de réparation et de transmission.
Une promesse comme point de départ
Le film s’ouvre sur une perte : celle de la mère, Siham, figure centrale du récit, disparue avant le père, Waguih. Huit ans plus tard, celui-ci meurt à son tour, et le réalisateur, leur fils, se retrouve seul face à un double deuil. Plus encore, il est confronté à une mission qu’il s’est lui-même assignée : raconter leur histoire, et par extension, la sienne.
Ce qui rend la tâche plus complexe, c’est que Namir Abdel Messeeh est un documentariste habitué à capter le réel sans toujours solliciter le consentement de ceux qu’il filme. Or, cette fois-ci, c’est sa propre intimité qu’il doit explorer. Il ne s’agit plus seulement d’observer, mais d’interroger, de ressentir, de se confronter aux silences familiaux, aux récits divergents, aux souvenirs lacunaires. Et surtout, de se livrer.
Un collage émotionnel et sensoriel
La mise en forme de cette quête intime prend une structure fragmentaire, qui épouse la nature même du souvenir. La Vie après Siham est un film kaléidoscopique qui mêle archives familiales, tournages contemporains, séquences en super 8 et extraits de vieux films égyptiens, notamment ceux de Youssef Chahine, figure tutélaire qui plane sur le film comme un double artistique. Le résultat est un collage visuel et émotionnel, où chaque image convoque une mémoire, une absence ou un écho.
La caméra s’attarde sur les gestes du père, sur les objets laissés par la mère, sur les lieux où elle a vécu. Elle filme aussi les hésitations du cinéaste lui-même, ses doutes, ses maladresses, sa douleur. On le voit interroger, se souvenir, parfois tourner en rond. Le film ne cache rien de ces moments de perte de contrôle, et c’est dans cette sincérité même qu’il trouve sa force.
La mémoire comme champ de bataille
L’une des dimensions les plus passionnantes du film réside dans son rapport à la vérité. En commençant par « la version officielle » de l’histoire familiale, telle qu’elle est racontée dans les réunions, Namir Abdel Messeeh découvre peu à peu que les récits de sa mère et de son père se contredisent, que certains événements ont été tus ou embellis, que la mémoire est un territoire mouvant, instable. Le documentaire devient alors enquête, mais une enquête sans résolution définitive : le réel est multiple, et chaque version a sa légitimité.
Cette confrontation avec les récits parentaux donne au film une dimension presque psychanalytique. Il ne s’agit plus seulement de rendre hommage aux morts, mais de comprendre ce qu’ils nous ont légué, consciemment ou non. Et ce legs est ambivalent : il contient de l’amour, bien sûr, mais aussi des contradictions, des non-dits, des blessures.
La quête d’un lieu d’appartenance
Si le film se déploie entre la France et l’Égypte, c’est parce que l’histoire familiale elle-même est traversée par l’exil. Les parents ont quitté leur pays d’origine, mais n’y ont jamais vraiment renoncé. Et le fils, né en France, navigue entre deux cultures, deux langues, deux manières d’être au monde.
La Vie après Siham interroge ainsi la notion de « pays natal » : est-ce une terre, une langue, une mémoire ? Le film ne donne pas de réponse tranchée, mais il montre avec acuité combien le sentiment d’appartenance peut être en même temps flou et important pour les enfants de l’immigration. À travers les photos, les chants, les films, c’est tout un pan d’histoire commune entre l’Égypte et la diaspora copte en France qui affleure, en creux.
La dimension politique du film est d’ailleurs présente, mais toujours en arrière-plan. Il n’y a pas de discours militant, mais une attention constante à ce que signifie « être arabe », « être égyptien », « être français », quand ces identités sont vécues au croisement de plusieurs mémoires.
Une catharsis par le cinéma
Plus qu’un film de deuil, La Vie après Siham est un film de transformation. Il ne cherche pas à fixer le passé, mais à l’interroger, à en faire émerger un sens, parfois douloureux, parfois salvateur. La promesse faite à la mère devient ainsi une forme de contrat moral, que le réalisateur honore avec délicatesse, sans pathos, mais avec une sensibilité à fleur de peau.
Comme dans ses précédents films, Namir Abdel Messeeh n’a pas peur de l’autodérision, du doute, de l’imperfection. Il filme sa propre vulnérabilité avec une honnêteté rare. Et c’est cette vulnérabilité, pleinement assumée, qui touche et qui reste.
Le cinéma, pour lui, est un lieu d’élaboration du réel, un outil pour dire l’indicible, pour réparer les brèches intimes, pour faire le deuil — non pas en oubliant, mais en transformant l’absence en mémoire active. C’est aussi, peut-être, une façon de devenir père à son tour, en transmettant ce qu’on a reçu, ou ce qu’on a tenté de comprendre.
Un accueil chaleureux et une reconnaissance internationale
La projection du film à Cannes a réuni l’ensemble de l’équipe, y compris les producteurs égyptiens, dans une ambiance d’appréciation sincère et d’enthousiasme partagé, tant du public que des critiques. Ce succès s’inscrit dans une trajectoire déjà marquée par une reconnaissance importante en Égypte et dans le monde arabe.
La Vie après Siham a reçu en 2021 deux prix des sponsors du Cairo Film Connection, ART et Ergo, en soutien à de nouvelles voix cinématographiques dans le monde arabe. Cette aide a permis la production de ce documentaire remarquable qui a su capter l’attention des festivaliers cannois. Ce soutien institutionnel souligne l’importance de plateformes telles que le Cairo Film Connection dans l’accompagnement des projets ambitieux de la région.
Mohamed Sayed Abdel Rahim, responsable des Cairo Industry Days au Festival International du Film du Caire, a exprimé sa grande satisfaction quant à l’accueil chaleureux réservé au film lors de sa première : « Nous sommes extrêmement fiers de voir l’un des projets du Cairo Film Connection connaître un tel succès international et une telle reconnaissance dans un festival aussi prestigieux que Cannes. Cette réussite illustre l’importance du soutien aux jeunes talents arabes et met en lumière le rôle catalyseur du Cairo Film Connection pour les projets cinématographiques ambitieux. »
Cette réussite illustre également le rôle grandissant du Festival International du Film du Caire et de sa plateforme industrie dans le développement du cinéma arabe, en offrant à ses talents une visibilité sur les scènes internationales et en renforçant la présence des créateurs égyptiens et arabes dans les grands forums mondiaux.
Neïla Driss