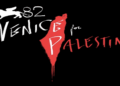Il y a 171 ans, Ahmed Bey a donné à la Tunisie le tout premier texte juridique ayant pour objet l’abolition complète de l’esclavage. Une première dans un monde qui voyait encore dans la traite négrière un commerce profitable.
Inutile de vous rappeler que l’enlisement des Etats-Unis dans une guerre civile en 1861 avait justement pour cause l’esclavage. L’enjeu majeur de son abolition était, comme chacun le sait, la rentabilité des plantations de coton du sud. Ce ne fut que le 18 décembre de 1865, qu’Abraham Lincoln a franchi le pas vers l’abolition de l’esclavage.
Bien avant les Etats-Unis, le 23 janvier 1846, le cachet beylical était apposé sur un document qui mettra fin à de longs siècles d’esclavage institutionnalisé en Tunisie. Car, rappelons-le, la pratique de l’esclavage y a fait son nid dès le VIIème siècle, lors de la conquête arabo-musulmane de l’Afrique du nord.
Retour sur l’histoire de la traite arabo-musulmane
Il faut reconnaitre que, par pur eurocentrisme, l’essentiel de la recherche académique sur le phénomène de l’esclavage vient mettre aux devants de la scène la traite transatlantique comme étant la plus horrible.
Alors que, pendant très longtemps, ce qu’il convient bien de nommer « la traite arabo-musulmane » était un phénomène plutôt périphérique. Pourtant, dans son livre « Le génocide voilé », l’anthropologue sénégalais Tidiane N’Diaye nous dit : « Alors que la traite transatlantique a duré quatre siècles, c’est pendant treize siècle sans interruption que les Arabes ont razzié l’Afrique subsaharienne ».
A vrai dire, revenir sur l’histoire de l’esclavage dans le monde arabo-musulman nous permet de découvrir que la traite arabe n’était pas seulement plus longue que la traite transatlantique, mais aussi plus cruelle à bien des égards.
Les pauvres eunuques
Pour n’en citer qu’un exemple, il y avait une ancienne pratique qui consistait à castrer la personne réduite en esclavage avant de l’envoyer servir ses futurs maitres dans les majestueux Palais de l’époque médiévale.
Cela existait à une époque où l’esclavage ne concernait pas seulement les populations de couleur noir. Les blancs de l’Europe de l’Est avaient aussi leur amère histoire avec la traite arabe et ottomane, en Tunisie comme dans tous les autres contrés arabo-musulmans.
Ce sont les fameux eunuques qui gardaient le harem du Bey. Sur un ton ironique, Victor Hugo se moqua des illettrés qui, pourtant, avaient une bibliothèque à la maison mais qui ne pouvait pas lire en disant « ils y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques ont un harem ».
Car, comme vous l’avez bien compris, ces pauvres eunuques étaient bien castrés.
Le décret du 23 janvier 1846
Il faut dire qu’avec ce fameux décret d’Ahmed Bey, un chapitre douloureux de l’histoire de notre pays se sera fermé à jamais, du moins sur le volet institutionnel. Car ce n’est pas tout de changer une loi. Il faut encore en assurer l’application. Et ce n’était pas aussi facile que l’on pourrait s’imaginer.
D’ailleurs, les maîtres ne remettaient pas facilement la lettre de manumission à leurs esclaves qui, parfois, ne savaient même pas qu’ils étaient libres. Même les affranchis connaitront une marche ambigüe ver la liberté, une liberté qui sera marquée du sceau de la dépendance.
Car, après une bonne bouffée de liberté, l’ex-esclave retournait assez souvent à l’ancien maitre. Et il n’y a pas de bon maitre, c’est la règle; qu’on n’en tienne pas grief aux hommes mais à la relation maitre-esclave qui est pourri.
L’apport du décret colonial de 1890
En réalité, il faudra attendre un deuxième décret d’abolition rétablissant progressivement les victimes de l’esclavage dans leurs droits et dignité. En fait, c’est à partir du décret colonial de 1890 que les anciens esclaves ne vivront plus chez leurs « maitres » en tant que domestiques, et connaitront aussi certains droits économiques et familiaux.
Les Français avanceront toujours le décret de 1890 comme étant le vrai premier décret d’abolition de l’esclavage en Tunisie. Non seulement ce n’est pas vrai, mais c’est surtout insensé de parler d’affranchissement lorsque tout le pays se trouvait sous le joug de la colonisation.
Cette querelle des dates, aussi secondaire qu’elle puisse paraître, revêt une importance symbolique pour une Tunisie indépendante, une Tunisie qui devrait se réapproprier son histoire nationale et choisir librement ses propres dates et moments phares.
Et lorsqu’on évoque l’abolition de l’esclavage en Tunisie, nous ne devrions pas manquer de mettre à l’actif d’Ahmed Bey sa décision progressiste en date du 23 janvier 1846.
Une fierté teintée de douleur
Quoi qu’il en soit, c’est une fierté nationale que de pouvoir fêter en Tunisie, chaque 23 janvier, la toute première abolition de l’esclavage dans le monde Arabe. Mais, cette date devrait aussi nous rappeler que, pas mieux que les européens, nous aussi, nous étions, à un moment de l’histoire, une société esclavagiste.
Nous devrions nous en rappeler d’autant plus que l’histoire de l’esclavage en Tunisie était si longue, si douloureuse, que l’on en trouve encore des séquelles dans notre société tunisienne contemporaine.
Mais c’est une autre histoire…
AA