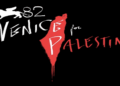L’Etat tunisien continue, sans aucun discernement, sa politique d’augmentation des prix afin de renflouer ses caisses et de financer un Budget 2021 en manque de ressources, au grand dam, cela va de soi, du citoyen. Après avoir revu à la hausse les prix des produits et services subventionnés (sucre, électricité, carburant, lait), le gouvernement s’attaque aux prix monopolisés des cigarettes, majorés à une moyenne de 15% depuis lundi dernier, 28 juin. Ça commence vraiment à sentir le roussi.
Malin est celui qui nous citerait un produit qui passera dorénavant entre les mailles des augmentations tellement les majorations touchent en moyenne un produit ou un service par semaine.
Bien entendu, nous ne parlons pas des produits et des services dont les prix sont libres, autrement dit fixés par le jeu de la concurrence sur le marché, qui constituent à peu près 90% des produits de consommation commercialisés.
Dans ce propos, il est question des produits homologués par l’Administration et dont l’ajustement de prix fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Economie, et qui paraît au JORT.
Une inflation trop forte est nocive
Notre économie vivra-t-elle prochainement une situation de stagflation (contraction des mots « stagnation » et « inflation »), c’est-à-dire une situation combinant à la fois une faible croissance économique et une inflation élevée ? A priori, nous ne sommes pas loin d’un tel scénario, en tout cas, tous les facteurs y concourent.
Après avoir chuté de 8,8% en 2020, notre croissance économique tarde à rebondir (1 ou 2% au plus en 2021) alors que le PIB de la zone euro devrait grimper de 4,3% et celui d’Afrique de 3,4%, malgré une conjoncture fortement impactée par la Covid.
Quant à l’inflation, quoiqu’elle se soit stabilisée dans nos contrées à 5% en mai, il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’elle ira crescendo (celle du mois de juin n’a pas été encore communiquée) au vu des récentes évolutions des prix des produits et services sus-cités.
Ceci dit, à quel scénario devons-nous s’attendre à l’avenir ? La réponse est symptomatique de l’attitude qu’observera la Centrale syndicale par rapport à cette spirale inflationniste, va-t-elle privilégier l’apaisement ou ira-t-elle à la confrontation avec le gouvernement ?
Les éléments dont nous disposons indiquent que l’UGTT est intransigeante quant au démarrage des négociations sociales dans les deux secteurs, public et privé. L’organisation ouvrière revendique une augmentation des salaires de manière à compenser la perte du pouvoir d’achat due à la hausse des prix. Et dans ce cas, le risque d’une stagflation sera imminent. Le gouvernement Mechichi est assis décidément entre deux chaises !
Quelles conséquences sur le climat des affaires ?
Ceci dit, si l’inflation continue à ce rythme de forte progression, avec la prochaine augmentation du tarif de l’eau et d’autres services et produits subventionnés, il s’ensuivra, inéluctablement, des répercussions dommageables pour l’économie tout entière.
Premièrement, au niveau de la compétitivité-prix des produits fabriqués localement par rapport aux produits fabriqués à l’étranger. Si nos produits deviennent plus chers que ceux importés, cela pénaliserait nos exportations et augmenterait la demande interne pour les produits étrangers (hausse des importations).
Il va sans dire qu’une baisse de l’activité des entreprises domestiques est susceptible d’entraîner des réductions d’effectifs et donc une progression du chômage.
Deuxièmement, une trop forte inflation pousserait les entreprises à adopter des comportements prudents en matière d’investissement et affecterait le cas échéant le potentiel de croissance.
Troisièmement, si les salaires ne sont pas indexés sur la hausse des prix, il est presque acquis que les ménages vont réduire leur consommation ou à désépargner pour maintenir leur niveau de vie.
Or, cette situation serait fatale pour l’économie : sachant que le taux d’épargne nationale a chuté de 21% à 4% en 10 ans, une nouvelle régression de cet indicateur serait préjudiciable pour l’investissement dont le taux a baissé, lui aussi, dangereusement, depuis 2010 (de 24,6%, il est passé à seulement 13,3% en 2020). Avec de tels taux, on ira droit vers la récession.
A titre comparatif, au Maroc, l’investissement brut a représenté 32,2% du PIB et est financé à hauteur de 86,4% par l’épargne nationale brute.
Chahir CHAKROUN
Tunis-Hebdo du 05/07/2021